
Vers la page d'accueil
L'INSEMINATION
 Dans la plupart des élevages laitiers français, l'objectif est d'obtenir en moyenne un veau par vache et par an. Cet objectif correspond à un intervalle moyen entre vêlages de 365 jours. L'écart entre vêlages dépend beaucoup de la mise à la reproduction, c'est à dire l'insémination. Celle-ci doit se situer autour de 60 jours après la mise bas précédente pour les vaches, et vers l'âge de 17 mois pour les génisses. La mise à la reproduction est un moment très délicat car il faut que l'éleveur arrive à détecter la chaleur chez la femelle. La détection des chaleurs est indispensable si l'on veut pratiquer l'insémination artificielle. Elle doit être réalisée consciencieusement pour pouvoir inséminer au moment optimum et avoir ainsi les meilleures chances de fécondation.
Dans la plupart des élevages laitiers français, l'objectif est d'obtenir en moyenne un veau par vache et par an. Cet objectif correspond à un intervalle moyen entre vêlages de 365 jours. L'écart entre vêlages dépend beaucoup de la mise à la reproduction, c'est à dire l'insémination. Celle-ci doit se situer autour de 60 jours après la mise bas précédente pour les vaches, et vers l'âge de 17 mois pour les génisses. La mise à la reproduction est un moment très délicat car il faut que l'éleveur arrive à détecter la chaleur chez la femelle. La détection des chaleurs est indispensable si l'on veut pratiquer l'insémination artificielle. Elle doit être réalisée consciencieusement pour pouvoir inséminer au moment optimum et avoir ainsi les meilleures chances de fécondation.
Détection des chaleurs.
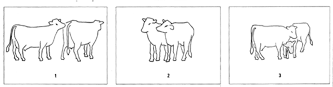
 Les chaleurs correspondent à la phase du cycle oestrien pendant laquelle la femelle accepte le chevauchement. Chez la femelle bovine adulte non gestante, elles apparaissent normalement tous les 21 jours. Leur durée est en moyenne de 15 heures.
Les chaleurs correspondent à la phase du cycle oestrien pendant laquelle la femelle accepte le chevauchement. Chez la femelle bovine adulte non gestante, elles apparaissent normalement tous les 21 jours. Leur durée est en moyenne de 15 heures.
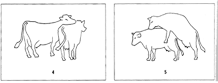 Comment détecter les chaleurs?
Comment détecter les chaleurs?
On a recours aux méthodes basées sur les modifications du comportement. Comme présentées dans la suite de schémas.
Les comportements habituels sont modifiés: réduction du temps consacré à l'alimentation et au repos, augmentation de l'activité déambulatoire. L'observation des animaux sera de préférence éffectuée aux périodes de moindre activité ou de repos. Les détections les plus efficaces sont en général faites le matin avant la traite ou l'affouragement, ou en fin de soirée. Une telle observation nécessite environ 40 minutes par jour (20 minutes le matin et 20 minutes le soir). Dans ces conditions, un agriculteur compétent peut espérer détecter 80 à 85 % des chaleurs. 15 % environ ne sont pas observées pour diverses raisons (chaleurs discrètes, à durée très limitée,...) sans qu'il y ait négligence de l'éleveur.
Pour faciliter l'observation, différentes méthodes faisant appel à des dispositifs spécifiques sont utilisées: marqueurs de chevauchement portés par les vaches (Kamar), gel sur la croupe... Mais, si elles permettent de réduire les temps d'observations, elles n'en dispensent pas. Par contre, le planning d'étable est un outil de suivi indispensable permettant de repérer immédiatement les vaches à surveiller.
Concrètement, les vaches reconnues en chaleur le matin seront inséminées l'après-midi et celles dont la chaleur commence l'après-midi ou dans la soirée seront inséminées le lendemain matin.
L'insémination

 La première insémination artificielle a été réalisée par Lauro Spallanzani en 1779 sur un chienne. Le premier centre d'insémination artificielle a vu le jour en 1936 au Danemark: 1700 vaches ont été inséminées la première année, avec 59% de fécondation.
La première insémination artificielle a été réalisée par Lauro Spallanzani en 1779 sur un chienne. Le premier centre d'insémination artificielle a vu le jour en 1936 au Danemark: 1700 vaches ont été inséminées la première année, avec 59% de fécondation.
Avant de pratiquer l'insémination, l'inséminateur en concertation avec l'agriculteur choisit, pour chaque vache, le taureau qui convient le mieux selon des postes comme la morphologie, la mamelle,...dans le but d'améliorer la génétique du troupeau. C'est le plan d'accouplement. De plus un nouvel outil (le programme Selectis) a été créé par l'URCEO pour aider a réaliser ce plan d'accouplement.
L'insémination artificielle (photo) consiste à déposer le sperme d'une paillette à l'aide d'un pistolet de Cassou dans les voies génitales de la vache. Ce pistolet est un cathéter de 5 à 6 mm de diamètre et de 40 à 45 cm de long. Il est équipé d'une seringue pour pousser le sperme.
Le cathéter est introduit dans le vagin en suivant son plafond, pour éviter l'orifice urinaire situé sur le plancher. Il pénètre ensuite le canal cervical. Pour cela, l'inséminateur prend le col de l'utérus avec sa main introduite dans le rectum de la vache, pour aider le cathéter à franchir les plis du col utérin. Le sperme du taureau est alors déposé. Un seul des spermatozoïdes aura le privilège de fusionner avec l'ovule, pour donner naissance à un oeuf, qui deviendra foetus.

Etape suivante

